
Ce doit être au printemps 1982, je n'ai pas quatorze ans. En bas de chez moi j'entends Jérôme garer sa petite Malaguti rouge : il veut me faire écouter quelque chose. De son sac U.S. il sort deux cassettes : le premier opus de Mötley Crüe et le premier album d'un groupe français aujourd'hui disparu : Warning. Même à cette distance, l'impression de l'époque me revient aussi net : celle d'une fureur sourde mais impériale, inédite pour moi en musique ; et dans un second temps, l'éblouissement, somme toute, devant la démonstration technique : ces gueules sombres, viriles et sophistiquées, n'entraient pas dans mes représentations du musicalement correct. Mais voilà : d'emblée, c'est ce qu'il me fallait - je n'ose dire ce que je cherchais. Des années durant, je vais me faire une sorte de militant de cette cause qui n'en est sans doute pas une, mais qui pour moi en est une alors puisque, derrière la musique, c'est toute une représentation du monde et de mes refus qui d'un coup s'imposait à moi. Dorénavant je n'écoute plus cette musique avec la même assiduité exclusive, tant s'en faut, mais, peu ou prou, elle continue de remuer les mêmes choses en moi et j'y prends un plaisir toujour égal ; quoique je le fasse sans doute d'une tout autre manière, à la manière d'un adulte qui aime à se remémorer les lieux où sa fabriqua un peu de ce qu'il est devenu.
 Je dirai ailleurs, plus tard (peut-être) dans un roman à venir, ce que fut cette musique et ce qu'elle représenta, non pour moi, mais pour ce que j'ose à peine appeler une génération, et ce que, même malgré elle, elle dit et continue de nous dire. Malgré elle car, hormis Trust, évidemment fameux, peu de groupes de hard-rock et de heavy metal s'acharnent à parler du monde comme il va. Le triptyque sex, drugs and rock'n'roll continue de dominer un univers où l'esprit de rébellion, voire de révolte, se contente le plus souvent d'être instinctif. Mais au moins cet esprit perdure-t-il et, quoiqu'on puisse regretter qu'il ne fût pas utilisé avec davantage de discernement, il vaut toujours mieux que l'immense et pitoyable soumission au système, voire l'invraisemblable gourmandise avec laquelle s'y vautrent maints artistes - souvent (mais pas toujours) des espèces d'animateurs pailletés venus à la musique par le biais de la mode, du mannequinat, du fric ou des concours de majorettes.
Je dirai ailleurs, plus tard (peut-être) dans un roman à venir, ce que fut cette musique et ce qu'elle représenta, non pour moi, mais pour ce que j'ose à peine appeler une génération, et ce que, même malgré elle, elle dit et continue de nous dire. Malgré elle car, hormis Trust, évidemment fameux, peu de groupes de hard-rock et de heavy metal s'acharnent à parler du monde comme il va. Le triptyque sex, drugs and rock'n'roll continue de dominer un univers où l'esprit de rébellion, voire de révolte, se contente le plus souvent d'être instinctif. Mais au moins cet esprit perdure-t-il et, quoiqu'on puisse regretter qu'il ne fût pas utilisé avec davantage de discernement, il vaut toujours mieux que l'immense et pitoyable soumission au système, voire l'invraisemblable gourmandise avec laquelle s'y vautrent maints artistes - souvent (mais pas toujours) des espèces d'animateurs pailletés venus à la musique par le biais de la mode, du mannequinat, du fric ou des concours de majorettes.
 L'image véhiculée par le rock depuis la fin des années soixante emprunte un chemin bien balisé : celui de la provocation, de la nique faite aux bonnes mœurs. C'est un cheminement plus ludique qu'il y paraît parfois : rien de plus plaisant que d'offenser la bourgeoisie, sa morale, sa puissance, son empire, ses clergés. Ce plaisir-là peut paraître gratuit, stérile, infantile, il n'en est pas moins sublime. Depuis les cries d'orfraie suscités en leur temps par les cheveux trop longs des Beatles (dont on oublie qu'ils furent associés aux pires violences juvéniles quand aujourd'hui des fils-à-papa s'embrassent sur leurs ritournelles dans des boums du samedi après-midi en buvant de la bière sans alcool) aux hauts-le-cœur qu'éveillèrent les pantalons trop moulés de Mick Jagger (quand des adolescentes dansent désormais presque entièrement nues dans des émissions de variété pour ménagères de cinquante ans), le spectre de la provocation et de la violence a entamé sa longue mue. Cette mue ne fait pourtant que calquer son évolution sur celle de la grande machine pornographique qu'est devenue notre société, où l'on peut, dans le même temps et sans contradiction apparente, vouloir envoyer des mineurs sans avenir aux Assises et oscariser des productions qui visent à l'hyper-réalisme dans la représentation de la violence - sous couvert de pratiques artistiques, naturellement.
L'image véhiculée par le rock depuis la fin des années soixante emprunte un chemin bien balisé : celui de la provocation, de la nique faite aux bonnes mœurs. C'est un cheminement plus ludique qu'il y paraît parfois : rien de plus plaisant que d'offenser la bourgeoisie, sa morale, sa puissance, son empire, ses clergés. Ce plaisir-là peut paraître gratuit, stérile, infantile, il n'en est pas moins sublime. Depuis les cries d'orfraie suscités en leur temps par les cheveux trop longs des Beatles (dont on oublie qu'ils furent associés aux pires violences juvéniles quand aujourd'hui des fils-à-papa s'embrassent sur leurs ritournelles dans des boums du samedi après-midi en buvant de la bière sans alcool) aux hauts-le-cœur qu'éveillèrent les pantalons trop moulés de Mick Jagger (quand des adolescentes dansent désormais presque entièrement nues dans des émissions de variété pour ménagères de cinquante ans), le spectre de la provocation et de la violence a entamé sa longue mue. Cette mue ne fait pourtant que calquer son évolution sur celle de la grande machine pornographique qu'est devenue notre société, où l'on peut, dans le même temps et sans contradiction apparente, vouloir envoyer des mineurs sans avenir aux Assises et oscariser des productions qui visent à l'hyper-réalisme dans la représentation de la violence - sous couvert de pratiques artistiques, naturellement.
 Nous vivons donc, sur ce sujet comme sur tant d'autres, au royaume de l'hypocrisie. Les sempiternelles offuscations suscitées par l'usage, récurrent dans le rock mais aussi de plus en plus dans la pop, d'un accoutrement sataniste, sado-masochiste, ou gothique, constituent sans doute la face la plus hilarante de cette hypocrisie. Longtemps, on nous a expliqués (et on continue de nous expliquer) que tel adolescent se serait suicidé après avoir écouté le morceau Stairway to heaven de Led Zeppelin en faisant passer le disque à l'envers, ou, plus explicitement, Suicide Solution d'Ozzy Osbourne. Mais qui songerait seulement à retirer des bibliothèques Les souffrances du jeune Werther, dont la publication avait entraîné en Allemagne une vague sans précédent de suicides chez de jeunes esprits romantiques ? Et que dire du cadavre de cette jeune fille, au côté duquel fut retrouvé un exemplaire de J'irai cracher sur vos tombes ouvert à la page même où est décrit un meurtre similaire ? L'on peut naturellement élargir la question à un ensemble d'autres représentations sociales : ainsi, nul n'osera décemment s'en prendre à André Gide, Oscar Wilde ou Thomas Mann, au prétexte de pédophilie. La société doit comprendre, selon le mot convenu, qu'elle ne sème que ce qu'elle récolte : une société autoritaire, moralisatrice et répressive doit faire son deuil d'une contestation policée. Cela ne signifie pas que tout ordre social mérite d'être systématiquement pourfendu, mais seulement que l'excès est dans tout, et partout. L'on ne peut à la fois s'acharner à mettre sur pieds le monde qu'avait prédit George Orwell - caméras de surveillance, délation institutionnalisée, hygiénisme sanitaire et social, démultiplication des signes extérieurs de la violence légale, assèchement utilitariste de la langue, mise en scène spectaculaire des politiques publiques, privatisation des espaces, interdictions comportementales en tous genres... - et déplorer que l'être humain n'accepte pas de lui-même et sans rechigner des limitations à sa liberté, limitations dont rien ne prouve qu'elles contribuent à l'extension du bien-être général et de la civilisation.
Nous vivons donc, sur ce sujet comme sur tant d'autres, au royaume de l'hypocrisie. Les sempiternelles offuscations suscitées par l'usage, récurrent dans le rock mais aussi de plus en plus dans la pop, d'un accoutrement sataniste, sado-masochiste, ou gothique, constituent sans doute la face la plus hilarante de cette hypocrisie. Longtemps, on nous a expliqués (et on continue de nous expliquer) que tel adolescent se serait suicidé après avoir écouté le morceau Stairway to heaven de Led Zeppelin en faisant passer le disque à l'envers, ou, plus explicitement, Suicide Solution d'Ozzy Osbourne. Mais qui songerait seulement à retirer des bibliothèques Les souffrances du jeune Werther, dont la publication avait entraîné en Allemagne une vague sans précédent de suicides chez de jeunes esprits romantiques ? Et que dire du cadavre de cette jeune fille, au côté duquel fut retrouvé un exemplaire de J'irai cracher sur vos tombes ouvert à la page même où est décrit un meurtre similaire ? L'on peut naturellement élargir la question à un ensemble d'autres représentations sociales : ainsi, nul n'osera décemment s'en prendre à André Gide, Oscar Wilde ou Thomas Mann, au prétexte de pédophilie. La société doit comprendre, selon le mot convenu, qu'elle ne sème que ce qu'elle récolte : une société autoritaire, moralisatrice et répressive doit faire son deuil d'une contestation policée. Cela ne signifie pas que tout ordre social mérite d'être systématiquement pourfendu, mais seulement que l'excès est dans tout, et partout. L'on ne peut à la fois s'acharner à mettre sur pieds le monde qu'avait prédit George Orwell - caméras de surveillance, délation institutionnalisée, hygiénisme sanitaire et social, démultiplication des signes extérieurs de la violence légale, assèchement utilitariste de la langue, mise en scène spectaculaire des politiques publiques, privatisation des espaces, interdictions comportementales en tous genres... - et déplorer que l'être humain n'accepte pas de lui-même et sans rechigner des limitations à sa liberté, limitations dont rien ne prouve qu'elles contribuent à l'extension du bien-être général et de la civilisation.
 Le heavy metal, dans ce panorama, occupe une place un peu à part. Contrairement aux punks, dont la rage contestatrice s'est vue peu à peu remplacée par la gouaille des rappeurs, les metalleux n'ont jamais eu le souci de la revendication ou de la mise à sac d'un ordre social. Au point d'ailleurs, comme de récentes études l'ont montré, que nombre d'entre eux étaient issus de la petite bourgeoisie. Cette indifférence à l'univers social n'est toutefois qu'apparente, ou relative. Sans doute la notion d'engagement, à quelques rares exceptions près, ne figure-t-elle pas au panthéon de l'éthique et de l'esthétique metalleuse : cela n'induit pourtant pas une indifférence au monde. Le hard-rock véhicule une forme de dégoût ou d'écoeurement du monde, disposition à laquelle il répond par une inversion de ses valeurs - ainsi le satanisme n'est-il utilisé que de manière rarissime pour ce qu'il est : le plus souvent, il ne manifeste qu'un souci de renversement des valeurs dominantes de la chrétienté occidentale - fussent-elles laïcisées. Ce qui est frappant dans le heavy metal, et spécialement depuis la fin des années quatre-vingt, c'est l'utilisation de thématiques merveilleuses, oniriques, légendaires, mythiques ou mythologiques (Iron Maiden, Rhapsody, Nightwish et tant d'autres ; ou encore, pour ceux qui se souviennent de la glorieuse décennie du heavy metal français, Sortilège). De manière sans doute assez inconsciente, les textes (qui ont toutefois assez peu d'importance dans cette musique, tant pour les musiciens que pour ses adeptes) tendent à évoquer un monde vu d'en haut, ou plus précisément d'un ailleurs fantasmé, et parfois nostalgique (les contrées nordiques nous fournissent aujourd'hui un bon exemple de cet appel au passé, à travers le recours au folklore, voire à des dialectes tombés en désuétude). Aussi le monde est-il souvent considéré à l'aune de ses périodes tragiques ou simplement charnières (la fin des dinosaures, les grandes conquêtes, les grands empires, l'esclavage, les guerres de religion, la survie de l'espèce, ou encore, et de manière plus récente, la destruction des écosystèmes) et de leurs conséquences sur la psyché collective et individuelle (le suicide, la perte d'identité, la dépression, le sentiment de sa propre incommunicabilité, la possibilité ou l'espoir d'un ailleurs, etc...). Dantec, Houellebecq, Lovecraft, Lautréamont, Coleridge, Poe, Huxley, pourraient, chacun à leur manière, refléter quelques-uns des tropismes metalleux. Contrairement au punk ou au rap, donc, il s'agit souvent d'une révolte non théorisée ; j'oserai dire, peut-être, une sorte d'anarchisme millénariste fasciné par la double idée de vide et de puissance. Autrement dit, si l'on marche en permanence sur un fil nihiliste, on n'en demeure pas moins sur le fil. A sa manière, il s'agit du seul genre à faire état, de manière presque exclusive, de la part maudite, à tout le moins sombre et retorse, de l'épopée humaine. Peu de perspective ou d'idéal social : seulement le grand récit de l'humanité.
Le heavy metal, dans ce panorama, occupe une place un peu à part. Contrairement aux punks, dont la rage contestatrice s'est vue peu à peu remplacée par la gouaille des rappeurs, les metalleux n'ont jamais eu le souci de la revendication ou de la mise à sac d'un ordre social. Au point d'ailleurs, comme de récentes études l'ont montré, que nombre d'entre eux étaient issus de la petite bourgeoisie. Cette indifférence à l'univers social n'est toutefois qu'apparente, ou relative. Sans doute la notion d'engagement, à quelques rares exceptions près, ne figure-t-elle pas au panthéon de l'éthique et de l'esthétique metalleuse : cela n'induit pourtant pas une indifférence au monde. Le hard-rock véhicule une forme de dégoût ou d'écoeurement du monde, disposition à laquelle il répond par une inversion de ses valeurs - ainsi le satanisme n'est-il utilisé que de manière rarissime pour ce qu'il est : le plus souvent, il ne manifeste qu'un souci de renversement des valeurs dominantes de la chrétienté occidentale - fussent-elles laïcisées. Ce qui est frappant dans le heavy metal, et spécialement depuis la fin des années quatre-vingt, c'est l'utilisation de thématiques merveilleuses, oniriques, légendaires, mythiques ou mythologiques (Iron Maiden, Rhapsody, Nightwish et tant d'autres ; ou encore, pour ceux qui se souviennent de la glorieuse décennie du heavy metal français, Sortilège). De manière sans doute assez inconsciente, les textes (qui ont toutefois assez peu d'importance dans cette musique, tant pour les musiciens que pour ses adeptes) tendent à évoquer un monde vu d'en haut, ou plus précisément d'un ailleurs fantasmé, et parfois nostalgique (les contrées nordiques nous fournissent aujourd'hui un bon exemple de cet appel au passé, à travers le recours au folklore, voire à des dialectes tombés en désuétude). Aussi le monde est-il souvent considéré à l'aune de ses périodes tragiques ou simplement charnières (la fin des dinosaures, les grandes conquêtes, les grands empires, l'esclavage, les guerres de religion, la survie de l'espèce, ou encore, et de manière plus récente, la destruction des écosystèmes) et de leurs conséquences sur la psyché collective et individuelle (le suicide, la perte d'identité, la dépression, le sentiment de sa propre incommunicabilité, la possibilité ou l'espoir d'un ailleurs, etc...). Dantec, Houellebecq, Lovecraft, Lautréamont, Coleridge, Poe, Huxley, pourraient, chacun à leur manière, refléter quelques-uns des tropismes metalleux. Contrairement au punk ou au rap, donc, il s'agit souvent d'une révolte non théorisée ; j'oserai dire, peut-être, une sorte d'anarchisme millénariste fasciné par la double idée de vide et de puissance. Autrement dit, si l'on marche en permanence sur un fil nihiliste, on n'en demeure pas moins sur le fil. A sa manière, il s'agit du seul genre à faire état, de manière presque exclusive, de la part maudite, à tout le moins sombre et retorse, de l'épopée humaine. Peu de perspective ou d'idéal social : seulement le grand récit de l'humanité.
Il peut paraître un peu saugrenu de la part d'un écrivain dont les goûts sont plutôt identifiés aux classiques, et manifestant le plus souvent une modération de pensée et d'expression, d'afficher ainsi un goût pour des domaines qui en sont a priori très éloignés - sans compter qu'il est autrement plus chic de disserter sur des arts plus nobles. Outre qu'il serait improductif d'y chercher une contradiction, je dirai ici même (mais plus tard...) pourquoi il est en ainsi, et pourquoi les préoccupations ou représentations metalleuses rejoignent parfois une certaine forme d'aspiration au classicisme...

/image%2F1371200%2F20240319%2Fob_4ed8d7_banniere-canalblog.jpeg)








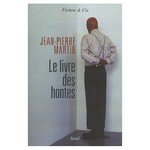

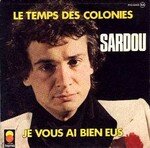



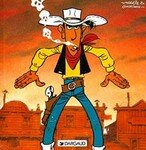

/image%2F1371200%2F20240409%2Fob_749b79_capture-d-ecran-2024-04-09-a-15-16.jpeg)